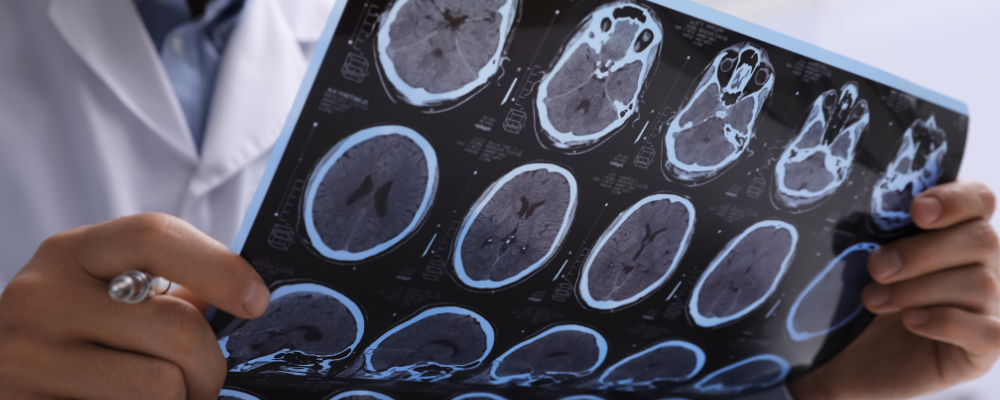DÉFINITION
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune car le système immunitaire s’attaque à la myéline, la gaine située autour des fibres nerveuses et nécessaire à la transmission de l’information nerveuse. De nombreuses cellules différentes sont impliquées dans la réponse immunitaire comme les lymphocytes T et B.
Cette maladie neurodégénérative conduit à des troubles moteurs, sensitifs et visuels qui peuvent grandement affecter la vie quotidienne : paralysie, fourmillements, douleurs et décharges électriques, perte de la vue, etc. On distingue plusieurs formes de SEP (du plus léger au plus sévère) :
- La syndrome clinique isolé représente un épisode unique de symptômes neurologiques évoquant la SEP ;
- La SEP récurrente-rémittente avec des récupérations totale ou partielle entre les poussées aiguës et peu d’évolution de la maladie ;
- La SEP secondaire progressive avec des récupérations partielles et une évolution de la maladie en dehors des poussées ;
- La SEP primaire progressive généralement sans poussées distinctes ni périodes de rémission avec une aggravation régulière des symptômes.
Elle est officiellement qualifiée d’incurable à ce jour. Cependant, nous avons publié plusieurs témoignages de guérisons naturelles de cette maladie (cf. magazine n° 8, La puissance du jeûne, et le témoignage de Daniel à la fin). Du point de vue épidémiologique, elle touche 80 personnes sur 100 000 en France, alors qu’elle n’en touche pas plus de 3 pour 100 000 en Asie et elle est absente chez les Inuits traditionnels, les Aborigènes d’Australie, les Kitavans de Papouasie Nouvelle-Guinée ou les Iakoutes de Sibérie¹. Pourquoi de telles différences ? Nous allons voir que l’environnement et le mode de vie y sont grandement pour quelque chose.
LA PISTE VIRALE : EPSTEIN BARR
Le virus Epstein Barr (VEB) est un virus de la famille de l’herpès, « le virus de l’herpès 4 », connu pour être responsable de la mononucléose. Après la rencontre avec ce virus, il persiste sous forme latente dans les lymphocytes B tout au long de la vie de l’hôte. Les résultats d’une méta-analyse établissent clairement un lien entre la rencontre avec le VEB et un antécédent de mononucléose infectieuse chez les sujets atteints de SEP². Les chercheurs ont montré que plus l’infection intervient tard, plus le risque de développer la SEP est élevé. Plus récemment, en janvier 2022, dans le cadre d’une vaste étude longitudinale, une équipe de chercheurs de Harvard affirment avoir obtenu des résultats qui démontrent que le VEB constitue un facteur déclencheur important de la SEP³. Pour cela, ils ont analysé les données d’une cohorte de plus de 10 millions de militaires actifs américains sur une période de 20 ans (1993-2013). Selon leurs données, le risque de SEP était 32 fois plus élevé après la rencontre avec le VEB, mais pas après la rencontre avec d’autres virus, y compris le cytomégalovirus transmis de façon similaire. La séropositivité de la VEB était presque omniprésente au moment du développement de la SEP, et seulement 1 des 801 cas de SEP était séronégatif à la VEB au moment de l’apparition de la SEP. Selon les chercheurs, les constatations fournissent des données convaincantes qui font de la VEB le déclencheur du développement de la SEP. La rencontre avec le VEB précédait non seulement l’apparition des symptômes, mais aussi le moment des premiers mécanismes pathologiques détectables sous-jacents à la SEP. Néanmoins, l’étude ne précise pas si le virus était dormant ou actif chez les personnes testées.
Par ailleurs, des chercheurs ont mis en évidence l’implication dans la SEP d’une protéine du VEB appelée EBNA1 (Epstein Barr Nuclear Antigen). Plus les symptômes du VEB sont forts, plus l’organisme produit des anticorps contre EBNA1. Or, on constate que les personnes atteintes de SEP ont des niveaux plus élevés d’anticorps contre EBNA1 que la normale. On suspecte ce que l’on appelle une « réaction croisée » dans le cas de la SEP et qui serait la cause des maladies auto-immunes en général. Comme nous l’avons expliqué dans plusieurs anciens numéros, la réaction croisée, appelée aussi « mimétisme moléculaire » est une situation où un anticorps spécifique à un antigène (substance étrangère non-désirée) attaque des protéines de notre corps qui sont structurellement proches de l’antigène ciblé. Le système immunitaire déploie des anticorps anti-EBNA1 qui, si la barrière hémato-encéphalique est altérée, attaquent la molécule d’adhésion des cellules gliales (GlialCAM), une protéine présente dans la myéline du cerveau qui ressemble à EBNA1⁴. Mais il semblerait que d’autres éléments soient aussi attaqués, comme les oligodendrocytes, cellules du système nerveux central ayant la capacité de fabriquer de la myéline.
Néanmoins, la plupart des personnes infectées par ce virus commun, soit environ 90 à 95 % de la population, ne développent pas la SEP. Selon nous, il ne faut pas parler de causalité mais plutôt de corrélation, voire de causalité inversée. Selon la vision hygiéniste, une détérioration du terrain (acidification et encrassement) provoque des lésions aux cellules nerveuses. Pour rappel, un des premiers signes du développement de la maladie est l’apparition de neurofilaments produits par les neurones et les axones en réponse à des lésions du tissu nerveux, on parle de biomarqueurs non spécifiques, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas spécifique à la SEP mais commun à toutes les neurodégénérescences. On assiste consécutivement à l’envahissement du cerveau par des lymphocytes T et des virus parce que le terrain le permet.
Par conséquent, il faut selon nous réunir certaines conditions de base pour voir cette multiplication virale au sein du cerveau :
- 1ère condition : la barrière hémato-encéphalique doit être perméable. Si les anticorps anti-EBNA1 n'atteignent pas le cerveau, ils ne peuvent pas attaquer la myéline. Une barrière hémato-encéphalique perméable qui laisse entrer des éléments non-désirés est souvent la conséquence d’une inflammation à proximité du cerveau. Les scientifiques mesurent les niveaux de métalloprotéase matricielle-9 (MMP-9) et de l’inhibiteur tissulaire de la métalloprotéinase (TIMP-1) pour mesurer la perméabilité de cette barrière. Il constatent que les patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) avaient des taux de MMP-9 comparables à ceux des patients atteints de maladies neurologiques inflammatoires, mais des taux plus élevés que les patients atteints de maladies neurologiques non inflammatoires et que les donneurs sains. La MMP-9 a augmenté dans la SEP-RR active par rapport à la SEP-RR inactive, ce qui signifie que la MMP-9 est liée à l’activité de la maladie. Une corrélation inverse a été observée entre le MMP-9 et son inhibiteur endogène TIMP-1⁵. De manière générale, lorsque les niveaux de MMP-9 sont élevés et les niveaux de TIMP-1 sont bas, il y a l’existence d’une inflammation cérébrale.
- 2e condition : le virus doit se réactiver. Une fois présent dans l’organisme, le VEB peut adopter une forme active et passive, c’est-à-dire qu’il peut rester en sommeil, même après avoir été actif. Les personnes épuisées, stressées chroniquement, ou en état de sidération sont très souvent en faiblesse immunitaire, donc plus à risque de développer une réactivation du virus VEB. Ainsi, si la rencontre avec le virus est difficile à éviter, on peut toutefois prévenir sa réactivation en évitant les facteurs déclenchants tels que le stress chronique, le surmenage, l’état de sidération maintenue, la malbouffe encrassante et carencée, l’intoxication au métaux lourds, les pollutions chimiques, la sédentarité ou encore le manque de sommeil qui affaiblissent tout autant le système immunitaire.
LA PISTES INTESTINALE : MICROBIOTE ET ALIMENTATION
La modification du microbiote intestinal pourrait être l’un des principaux facteurs qui contribuent à la SEP. Des données probantes suggèrent que certains profils de microbiotes intestinaux pourraient être liés à la sensibilité ou à la protection contre la maladie¹⁶. Comme nous l’avons vu, le microbiote semble impliqué dans la modulation du système immunitaire, il modifie l’intégrité et la fonction du barrière hémato-encéphalique, déclenche la démyélinisation auto-immune et interagit directement avec différents types de cellules présentes dans le SNC. Il a d’ailleurs été démontré que les personnes atteintes de SEP ont un microbiome altéré, une perméabilité intestinale accrue et des changements dans le métabolisme de l’acide biliaire. Le régime alimentaire, l’utilisation généralisée d’antibiotiques et le style de vie peuvent exercer un impact profond sur les intestins.
Les personnes atteintes de SEP se plaignent souvent de symptômes plus graves après avoir consommé des produits laitiers. Les chercheurs ont maintenant trouvé une cause possible à cela. Selon l’étude, la caséine (protéine) dans le lait de vache peut déclencher une inflammation qui cible la myéline⁶. Les défenses du corps attaquent la caséine, mais elles détruisent également une protéine appelée MAG (Myelin-Associated Glycoprotein) qui ressemble beaucoup à la caséine à certains égards et qui est impliquée dans la formation de la myéline. L’étude a été en mesure de démontrer ce lien chez la souris, mais a également trouvé des preuves d’un mécanisme similaire chez l’humain. Les études indiquent que les taux de SEP sont élevés dans les populations où le lait de vache est consommé en quantité. Toutefois, cela ne touche que les patients atteints de SEP allergiques à la caséine et il est possible que différents types de produits laitiers affectent la SEP différemment. En effet, les personnes allergiques à la caséine ont la barrière intestinale perméable, ce qui laisse passer dans le sang cette protéine non correctement digérée. De surcroît, certains produits laitiers comme le beurre ou le ghee ne contiennent quasiment plus de caséine.
Le travail retentissant du Pr Roy Laver Swank de la Swank Multiple Sclerosis Clinic à Portland (États-Unis) montre que l’incidence de la SEP dans les pays semblait suivre la consommation de gras saturés, en particulier les produits laitiers, et était plus faible là où la consommation de poisson, riche en gras oméga-3, était élevée⁷. Dans son livre intitulé The Multiple Sclerosis Diet Book, il préconise un régime à faible teneur en gras saturés et une augmentation des huiles polyinsaturées riche en oméga-6 et oméga-3. On retrouve ces gras saturés essentiellement dans les graisses animales, les produits laitiers, l’huile de coco, l’huile de palme mais aussi dans de nombreux aliments transformés comme les g'teaux, les biscuits et les p'tisseries. Pourtant, les gras saturés, comme les acides gras insaturés, sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme (voir notre explication p. 64). On peut donc supposer que la nocivité des régimes riches en gras saturés tient au fait qu’ils contiennent beaucoup d’aliments transformés, de sucres et de céréales, de produits laitiers (avec les problèmes que nous avons vu juste au dessus), et trop d’oméga-6 comme c’est le cas dans le fameux Standard American Diet. Ainsi, il est aussi extrêmement important d’éviter les gras modifiés, c’est-à-dire les gras raffinés et fabriqués par l’humain
LA PISTE ENVIRONNEMENTALE
Le taux de vitamine D
Le facteur génétique lui-même ne représente pas plus de 30 % des cas de SEP¹⁰ et on sait que les facteurs environnementaux sont impliqués dans la SEP¹¹. Parmi ces facteurs, on évoque le taux de vitamine D. Une étude portant sur 7 millions de militaires américains suggère qu’un taux élevé de vitamine D en circulation est associé à un risque moindre de SEP¹². D’autres études viennent appuyer cette observation¹³. Une supplémentation à hauteur 50 000 UI de vitamine D3 par semaine pendant 12 mois a permis de faire baisser de 70 % le risque de l’apparition de la SEP¹⁴.
Le tabagisme
Plusieurs études montrent que le tabagisme contribue à la fois à accroître le risque de développer la maladie mais aussi à accélérer l’évolution de la maladie d’une forme récurrente intermittente à une forme progressive plus grave¹⁵. Le risque relatif de développer la SEP est d’environ 1,5 pour les fumeurs comparativement aux non-fumeurs. De plus, il peut y avoir d’importantes interactions entre le tabagisme, les antécédents génétiques d’une personne et d’autres expositions à des risques environnementaux.
LA PISTE VACCINALE
Depuis la mise en œuvre de la campagne de vaccination de masse contre l’hépatite B en France, l’apparition de la SEP, parfois au lendemain des vaccinations, a conduit à la publication d’études épidémiologiques internationales. Cela était également justifié par la forte augmentation de l’incidence annuelle de la SEP signalée à l’assurance maladie française au milieu des années 1990. Nous vous invitons à lire l’analyse méticuleuse de Dominique Le Houézec intitulée Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination (2014). Elle montre en détail que l’application de chaque critère de Hill (groupe de conditions minimales pour fournir une preuve adéquate d'une relation causale entre deux événements) aux données officielles ainsi qu’à l’agence nationale de pharmacovigilance indique que la corrélation entre le vaccin contre l’hépatite B et la SEP peut être causale. La force de cette analyse est qu’elle est basée sur des données officielles incontestables, sur de grands nombres et s’étend sur environ 12 ans. Il explique également que la plupart des publications où on affirme qu’il n’existe aucun lien entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la SEP ont reçu des subventions de l’industrie pharmaceutique. Enfin, la méta-analyse¹⁷ ne révélant pas de changement significatif dans le risque de développer la SEP après le vaccin HB chez les adultes peut également être critiquée avec le retrait d’une étude positive et la modification du résultat d’une autre, ce qui permet plus facilement un résultat négatif.
CONCLUSION
Le stress chronique, la malbouffe, le tabagisme, le manque d’ensoleillement, les toxiques, les pollutions et d’autres facteurs délétères participent à l’encrassement du terrain. Un terrain encrassé favorise l’inflammation. Lorsque l’organisme est enflammé, les barrières intestinale et hémato-encéphalique deviennent plus poreuses. Elles ne jouent plus leur rôle correctement, elles laissent donc entrer des éléments qui n’auraient pas dû passer, comme les lymphocytes T et les virus comme celui d’Epstein Barr. Selon nous, le corps ne s’attaque jamais lui-même, même si c’est ce qui est officiellement affirmé concernant les maladies dites auto-immunes. Au contraire, nous sommes persuadés que le corps travaille toujours à nos côtés pour nous protéger. Ce qui attaque ou détériore l’organisme, ce sont l’acidification, l’oxydation, la calcification qui sont la conséquence de nos modes de vie. Ainsi, lorsque le terrain est dégradé et pollué, notre hypothèse (selon la théorie du virus utile) est que le virus s’active et se réplique dans le but de diffuser une nouvelle information aux cellules. Ces informations participent à l’adaptation et à la mise en place de mécanismes de nettoyage et de survie. Le VEB participerait par exemple à nettoyer les métaux toxiques. Mais si ces processus dépassent beaucoup trop la capacité de l’organisme, et que rien n’est fait pour rétablir le terrain, alors la maladie progresse et la neurodégénérescence est inévitable.
Sources :
¹ Source : https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Who-Gets-MS
² Source : An updated meta-analysis of risk of multiple sclerosis following infectious mononucleosis, 2010 (Handel et al.)
³ Source : Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis, 2022 (Bjornevik et al.)
⁴ Source : Clonally expanded B cells in multiple sclerosis bind EBV EBNA1 and GlialCAM, 2022 (Lanz et al.)
⁵ Sources : Intrathecal synthesis of matrix metalloproteinase-9 in patients with multiple sclerosis: implication for pathogenesis, 2002 (Liuzzi et al.) / TIMP-1 resistant matrix metalloproteinase-9 is the predominant serum active isoform associated with MRI activity in patients with multiple sclerosis, 2015 (Trentini et al.)
⁶ Source : Antibody cross-reactivity between casein and myelin-associated glycoprotein results in central nervous system demyelination, 2022 (Chunder et al.)
⁷ Sources : Effect of low saturated fat diet in early and late cases of multiple sclerosis, 1990 (Swank et Dugan) / Multiple sclerosis: a correlation of its incidence with dietary fat, 1950 (Swank) / Multiple sclerosis: fat-oil relationship, 1991 (Swank) / Review of MS patient survival on a Swank low saturated fat diet, 2003 (Swank)
⁸ Source : Sodium intake is associated with increased disease activity in multiple sclerosis, 2014 (Farez et al.)
⁹ Source : Dietary salt intake and time to relapse in paediatric multiple sclerosis, 2016 (Nourbakhsh et al.) / Sodium intake and multiple sclerosis activity and progression in BENEFIT, 2017 (Fitzgerald et al.)
¹⁰ Source : Genetics of Multiple Sclerosis: An Overview and New Directions, 2018 (Patsopoulos)
¹¹ Source : Environmental risk factors and multiple sclerosis: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses, 2015 (Belbasis et al.)
¹² Source : Serum 25-hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis, 2006 (Munger et al.)
¹³ Sources : Comparison of vitamin D3 serum levels in new diagnosed patients with multiple sclerosis versus their healthy relatives, 2013 (Mazdeh et al.) / Vitamin D levels and risk of multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndromes, 2014 (Martinelli et al.)
¹⁴ Source : Preventive effect of vitamin D3 supplementation on conversion of optic neuritis to clinically definite multiple sclerosis: a double blind, randomized, placebo-controlled pilot clinical trial, 2012 (Derakhshandi et al.)
¹⁵ Sources : Oral contraceptives and reproductive factors in multiple sclerosis incidence, 1993 (Villard-Mackintosh et Vessey) / The influence of oral contraceptives on the risk of multiple sclerosis, 1998 (Thorogood et Hannaford) / Cigarette smoking and incidence of multiple sclerosis, 2001 (Hernán et al.) / Cigarette smoking and the progression of multiple sclerosis, 2005 (Hernán et al.) / Smoking and Disease Progression in Multiple Sclerosis, 2010 (Healy et al.) / Smoking is associated with progressive disease course and increased progression in clinical disability in a prospective cohort of people with multiple sclerosis, 2009 (Pittas et al.)
¹⁶ Sources : Multiple sclerosis patients have a distinct gut microbiota compared to healthy controls, 2016 ( Chen et al.) / Alterations of the human gut microbiome in multiple sclerosis, 2016 (Jangi et al.) / Dysbiosis in the Gut Microbiota of Patients with Multiple Sclerosis, with a Striking Depletion of Species Belonging to Clostridia XIVa and IV Clusters, 2015 (Miyake et al.) / Environmental control of autoimmune inflammation in the central nervous system, 2016 (Rothhammer et Quintana) / The role of microbiome in central nervous system disorders, 2014 (Wang et Kasper) /Combined therapies to treat complex diseases: The role of the gut microbiota in multiple sclerosis, 2018 (Calvo-Barreiro et al.) / Focus on the gut-brain axis: Multiple sclerosis, the intestinal barrier and the microbiome. World J. Gastroenterol, 2018 (Camara-Lemarroy et al.) / The Role of the Gut Microbiome in Multiple Sclerosis Risk and Progression: Towards Characterization of the “MS Microbiome” Neurotherapeutics, 2018 (Probstel et Baranzini) / The “Gut Feeling”: Breaking Down the Role of Gut Microbiome in Multiple Sclerosis. Neurotherapeutics, 2018 (Freedman et al.)
¹⁷ Source : Immunizations and risk of multiple sclerosis: systematic review and meta-analysis, 2011 (Farez et Correale)
Cet article a été écrit par Estelle Sovanna et il est issu du magazine Régénère n°16 "Cerveau, corps et santé".