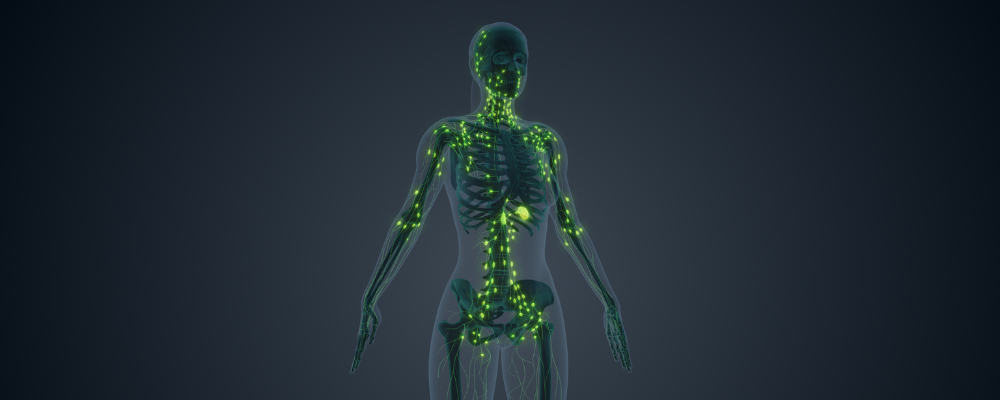DÉFINITION
La dépression, ou dépression nerveuse, correspond à une perturbation durable de l’humeur caractérisée par une tristesse constante, un abattement, une perte d'intérêt et de plaisir pour des activités du quotidien et aussi pour les activités habituellement agréables, une réduction de l'énergie ou une fatigabilité anormale, et une auto-dévalorisation. Elle se différencie des sautes d’humeur passagère par sa durée (au moins 15 jours) et par ses conséquences sur la santé globale. La dépression est en effet associée à la perte du sommeil, la difficulté de concentration, aux troubles de mémoire, la perte de la libido, le repli sur soi-même. Elle est la plus courante des troubles mentaux et toucherait deux fois plus les femmes que les hommes.
Il existe plusieurs types de dépression :
- La dysthymie est un état dépressif chronique trouble moins sévère que la dépression nerveuse. Elle est néanmoins handicapante et peut évoluer vers une forme plus grave.
- La dépression récurrente correspond à la succession d’épisodes dépressifs à intervalles réguliers. L’individu peut expérimenter plusieurs mois ou années sans symptômes avant qu’un nouvel épisode dépressif ne survienne.
- La dépression bipolaire se manifeste par une alternance entre des phases dépressives et des phases d’euphorie maniaque où la personne est exaltée avec peu d’envie de dormir.
- La dépression post-partum (dépression postnatale) survient pendant l’année suivant l’accouchement généralement à cause des bouleversements hormonaux, du manque de sommeil, de l’épuisement, du changement brutal provoqué par l'arrivée du bébé.
- La dépression saisonnière (trouble affectif saisonnier) est liée à la baisse de lumière naturelle en automne et en hiver. Cette baisse impacte notre horloge biologique et bouleverse notre physiologie.
- La dépression chez les personnes 'gées s’accompagne souvent de pertes de mémoires et de troubles de la concentration. Elle est souvent liée à d’autres pathologies neurologiques liées à l’'ge comme la démence, la maladie d’Alzheimer et de Parkinson.
- La dépression infantile et juvénile se traduit souvent par des difficultés à se concentrer, de l’anxiété et des troubles du sommeil.
On constate une véritable explosion des épisodes dépressifs au cours des dernières décennies. C’est pourquoi, certains chercheurs comme Brandon H. Hidaka la qualifient de « maladie de la modernité ». Pourquoi une telle évolution ? Encore une fois, c'est dans l’étude de l’environnement et de l’hygiène de vie des populations que nous allons trouver nos meilleures réponses.
LA PISTE DE L’ÉPUISEMENT
Le terme de dépression (dé–pression) parle de lui-même : une dé-pression s’opère suite à un excès de pression vécu par l’individu. Un épisode de contrainte dépassant la capacité adaptative de l’individu conduit à un épuisement des réserves nerveuses et hormonales, notamment l’adrénaline. On qualifie ces états d’épuisement généralisé ou encore de burn-out. Ce défaut de production d’adrénaline entraîne une chute de la pression artérielle systolique, qui à son tour provoque un manque de perfusion sanguine dans toute la zone cérébrale (en particulier le lobe frontal). Comme le conclut une étude en date d’avril 2019 dans le British Journal of Psychiatry : « une plus faible perfusion du lobe frontal, liée à des valeurs inférieures de la pression artérielle systolique de base, est associée à des symptômes dépressifs cliniquement significatifs »¹.
Cette intrication entre épuisement et dépression est également clairement exprimée dans une étude qui cherche à différencier le burn-out (épuisement professionnel) et la dépression : « Historiquement, cependant, l’épuisement a été difficile à séparer de la dépression. En effet, les symptômes de l’épuisement coïncident avec les symptômes de la dépression. Les preuves de la validité discriminante de l’épuisement professionnel à l’égard de la dépression sont faibles, tant au niveau empirique que théorique. L’épuisement émotionnel, le noyau de l’épuisement, reflète une combinaison d’humeur déprimée et de fatigue/perte d’énergie et est très fortement corrélée avec d’autres symptômes dépressifs. Les facteurs de risque d’épuisement professionnel sont également des prédicteurs de dépression. Les facteurs de risque individuels de dépression (p. ex., épisodes dépressifs antérieurs) sont également des prédicteurs de l’épuisement professionnel. Dans l’ensemble, l’épuisement professionnel est susceptible de refléter un processus dépressif "classique" qui se déroule en réaction à un stress insoluble »².
Il est important de préciser que le stress est toujours une réaction physiologique à une contrainte perçue. Ainsi c’est notre interprétation d’un événement plutôt que l’événement en lui-même qui génère le stress. Le psychologue britannique Hans Eysenck définit le neuroticisme comme un trait de personnalité des individus possédant un système nerveux sympathique réactif et une faible intelligence émotionnelle (capacité à reconnaître et maîtriser ses émotions). Ces personnes ont une tendance persistante à l'expérience des émotions négatives. Ce neuroticisme a été identifié comme un facteur causatif dans l’apparition des épisodes dépressifs par épuisement, dans les crises d’anxiété et d’angoisse, et dans les douleurs musculo-squelettiques associées au syndrome de fatigue et à la dépression³.
LA PISTE DU TROUBLE DU RYTHME CIRCADIEN
Des troubles circadiens ont été observés chez des personnes atteintes de dépression. La gravité des troubles dépressifs majeurs est corrélée au degré de désalignement des rythmes circadiens⁴. Le rythme circadien est un rythme biologique interne d’une durée de 24 heures environ (voir plus en détail p. 64). Il régule nos cycles veille-sommeil mais aussi la température du corps, la sécrétion d’hormones et plus généralement le fonctionnement des organes. L’élément majeur qui marque un trouble du rythme circadien est la perturbation du sommeil. D’ailleurs, les troubles du sommeil sont courants chez les patients souffrant de dépression. Jusqu’à 90 % des patients déprimés affirment avoir de la difficulté à s’endormir, à rester endormis et à se réveiller tôt le matin⁵, tandis qu’une proportion moindre (6 % à 29 %) se plaint d’hypersomnie⁶. On sait que les patients déprimés présentent une durée de sommeil paradoxal plus longue, un nombre accru de mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal et une diminution du sommeil profond à ondes lentes, comparativement aux sujets en santé⁷. Les troubles de l’insomnie précèdent souvent l’apparition et la récidive de la dépression⁸. De plus, les troubles d’insomnie et d’hypersomnie sont associés à une augmentation de la suicidalité⁹. Dans le trouble bipolaire, l’insomnie précède et persiste souvent pendant les épisodes maniaques, tandis que l’insomnie et l’hypersomnie peuvent précipiter et perpétuer des épisodes et des symptômes dépressifs¹⁰. Ces observations suggèrent un rôle critique des perturbations circadiennes et du sommeil dans la physiopathologie de la dépression.
Notre horloge interne détermine aussi notre production de cortisol, avec un pic normalement le matin au réveil, et notre production de mélatonine le soir. Or, des études ont montré que les patients déprimés avaient des rythmes circadiens avancés pour le cortisol et la norépinéphrine¹¹, ainsi qu’une sécrétion instable et erratique. La réponse du cortisol aux événements négatifs est aussi atténuée par rapport aux sujets sains¹². Des niveaux et des tendances anormales de sécrétion de mélatonine ont également été observés chez des patients déprimés¹³. Enfin, plusieurs études ont en effet montré que les rythmes sociaux sont perturbés et moins réguliers chez les patients souffrant de troubles anxieux et de l’humeur ainsi que chez les personnes qui vivent des événements stressants¹⁴.
LA PISTE INTESTINALE (ALIMENTATION ET MICROBIOTE)
L’alimentation
On remarque des comportements alimentaires similaires chez des personnes dépressives : un manque d'appétit ou une envie compulsive de manger tout au long de la journée, le fait de sauter des repas, un désir dominant d'aliments sucrés ou de nourriture ultra transformée. Il s’avère que plus la quantité de micronutriments est pauvre dans le régime et plus les risques d’épisodes dépressifs sont élevés¹⁵. Le calcium est depuis longtemps identifié comme un minéral indispensable au fonctionnement normal du système nerveux/cognitif. Des carences en calcium peuvent avoir de lourdes conséquences et être facteur de prédisposition à la dépression¹⁶. Ceci est d’autant plus important à souligner que les antidépresseurs de type inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) inhibent l'absorption du calcium¹⁷, créant ainsi une forme de cercle vicieux. D’autres minéraux comme le chrome, le lithium, l’iode, le sélénium ou le zinc ont été identifiés comme extrêmement importants pour la survenue, ou non, d’épisodes dépressifs¹⁸. Le fer revêt lui aussi une importance capitale. Il est nécessaire à l'oxygénation et à la production d'énergie dans le parenchyme cérébral, ainsi qu'à la synthèse des neurotransmetteurs et de la myéline. La carence en fer se retrouve chez les enfants présentant un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité. Elle est associée à une perturbation du développement des fonctions cognitives. Les femmes sont deux fois plus carencées en fer que les hommes, cette différence entre les sexes commençant à l'adolescence et s'accentuant avec la venue des enfants. Ceci explique certainement pourquoi les femmes en 'ge de procréer souffrent davantage de dépression qu'à d'autres moments de leur vie, l’anémie ferriprive étant associée à l'apathie, à la dépression et à la fatigue rapide lors de l'exercice.
Le microbiote
Comme nous l’avons vu dans un numéro précédent (cf. magazine n°11 – Nos précieux intestins), l'axe intestin-cerveau est un réseau de communication bidirectionnel (qui fonctionne dans les deux sens) reliant le système nerveux entérique (SNE) et le système nerveux central (SNC). Ce réseau n'est pas seulement anatomique (via le nerf vague), il inclut également les voies de communication endocriniennes, humorales, métaboliques et immunitaires. De nouvelles preuves suggèrent que le microbiome intestinal influence la fonction cognitive via cet axe. Le microbiote est fortement perturbé par l’alimentation moderne occidentale, appelé également Standard American Diet (Régime Américain Standard en français). Elle comprend des quantités élevées d’aliments transformés, de la viande rouge, des produits laitiers riches, des sucres et céréales raffinés et des plats préparés. Ce régime modifie considérablement les proportions de bactéries commensales dans le tractus gastro-intestinal¹⁹. Lors d’une dysbiose, les bactéries intestinales déclenchent la production de lipopolysaccharides (LPS). Les LPS vont à leur tour activer des réponses inflammatoires via la libération de cytokines. Cette inflammation entraîne une altération de la perméabilité intestinale et de l’intégrité de la barrière hématoencéphalique, rendant ainsi le cerveau plus vulnérable à l’afflux de substances nocives de la circulation. La consommation de produits transformés issus d’une alimentation moderne occidentale augmente également la production d’endotoxines par les bactéries commensales, ce qui peut favoriser la neuroinflammation et le dysfonctionnement cognitif. Le professeur Turhan Canli disait d’ailleurs : « Plusieurs études post-mortem rapportent la présence de marqueurs de l’inflammation dans le cerveau des dépressifs majeurs, notamment dans la zone de régulation des émotions ». Des résultats récents montrent également que les altérations induites par le régime alimentaire dans le microbiote intestinal altèrent la sensibilité à l’insuline périphérique, ce qui est associée à une perturbation de l’hippocampe et aux déficits mnémoniques. Tous ces résultats ont permis l'émergence ces dernières années de l’entéro-psychiatrie, discipline qui lie la psychiatrie à l’état de nos intestins.
LA PISTE HORMONALE
Il existe un risque accru de trouble dépressif majeur chez les femmes par rapport aux hommes²⁰. Ce risque est particulièrement marqué après la puberté et tout au long du cycle de vie reproductif, ce qui nous suggère que les hormones sont fortement impliquées. L'hypothèse selon laquelle les fluctuations des hormones sexuelles pourraient influencer les voies neurochimiques liées à la dépression est largement étayée par des études¹¹. D’ailleurs, les hormones et les neurotransmetteurs partagent des voies et des sites récepteurs communs dans les zones du cerveau liées à l’humeur. Par exemple, il a été démontré que les œstrogènes et la progestérone affectent des régions connues pour être impliquées dans la modulation de l'humeur et du comportement. Des sites récepteurs pour ces hormones ont été identifiés dans le cortex préfrontal, l'hippocampe, le thalamus et le tronc cérébral²¹. Une sensibilité accrue à d’intenses fluctuations hormonales pourrait donc expliquer la dépression touchant les femmes lors des syndromes prémenstruels, du post-partum et de la ménopause²². Pendant la ménopause par exemple, les ovaires cessent de fonctionner, la sécrétion d'hormone folliculo-stimulante (FSH) augmente. Or, cette augmentation rapide des niveaux de FSH est associée à un risque accru de présenter des symptômes dépressifs chez les femmes ménopausées²³. De la même manière, les fluctuations hormonales sont particulièrement intenses à la fin de la phase lutéale du cycle menstruel et au début des règles²⁴, c’est pourquoi certaines femmes sont particulièrement sujettes à des sautes d'humeur, de l'irritabilité et de la nervosité. Par ailleurs, pour certaines femmes, la grossesse peut être une période à risque élevé de morbidité psychiatrique, en particulier de troubles dépressifs et anxieux²⁵.
ET LA SÉROTONINE DANS TOUT ÇA ?
Un faible taux de sérotonine est associée à l'agressivité, l’impulsivité et la dépression. C’est pourquoi, l’une des classes de médicaments les plus utilisés lors d'un diagnostic de dépression sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Ces molécules vont limiter la recapture de la sérotonine au niveau de la synapse et donc augmenter de fait la quantité de sérotonine disponible. Néanmoins, l’humeur est une combinaison d’éléments complexes qui comprennent aussi d’autres neurotransmetteurs comme le GABA ou la dopamine. Le bien-être dépend bien plus d’un équilibre entre tous ces éléments plutôt qu’une question de quantité.
LA PISTE VIRALE
Des recherches récentes ont montré que certaines infections virales seraient associées à une augmentation de la prévalence de la dépression par rapport à la population générale. En effet, on sait que des développements viraux peuvent toucher directement le cerveau et être associés à des troubles de l’humeur ou une déficience cognitive²⁶.
CONCLUSION
La dépression est multifactorielle mais nous savons qu’elle s’exprime sur un terrain généralement déphasé, épuisé,encrassé et perturbé. Des niveaux de stress élevés et un épuisement entraîne un défaut de perfusion au niveau cérébral. Une mauvaise alimentation génératrice de déchets entraîne une dysbiose intestinale et une inflammation générale. L'inflammation rend notre barrière intestinale et hémato-encéphalique plus perméable, ce qui favorise le passage d’endotoxines et de microbes non-désirés dans le cerveau. Les virus dormants présents dans l’organisme peuvent se réactiver et se répliquer si notre immunité fait défaut, ce qui est très souvent le cas lors de longues périodes de stress. Leur activation donne lieu à de nombreux symptômes, y compris la dépression.
Sources :
¹Source : The association between frontal lobe perfusion and depressive symptoms in later life, 2019 (Robert Briggs et al.)
²Source : What is the difference between depression and burnout? An ongoing debate, 2018 (Irvin Sam Schonfeld et al.)
³Source : Fatigue symptoms in relation to neuroticism, anxiety-depression, and musculoskeletal pain. A longitudinal twin study, 2018 (Olav Vassend et al.)
⁴Source : Circadian misalignment in major depressive disorder, 2009 (J. Emens et al.)
⁵Sleep complaints among older general practice patients: association with depression, 2005 (Almeida OP and Pfaff JJ.) / Sleep and depression, 2005 (Tsuno N et al.)
⁶Source : Sleep complaints and depression in an aging cohort: a prospective perspective, 2000 (Roberts RE et al.)
⁷Source : The neurobiology of depression: perspectives from animal and human sleep studies, 2003 (Shaffery J et al.) / Sleep and depression, 2005 (Tsuno N et al.)
⁸Source : Risk factors for depression among elderly community subjects: a systematic review and meta-analysis, 2003 (Cole MG and Dendukuri N.) / Self-reported sleep disturbance as a prodromal symptom in recurrent depression, 1997 (Perlis ML et al.) / Primary insomnia: a risk factor to develop depression?, 2003 (Riemann D. and Voderholzer U.) / Place of chronic insomnia in the course of depressive and anxiety disorders, 2003 (Ohayon MM and Roth T.)
⁹Source : Sleep disturbances and suicidal behaviour in patients with major depression, 1997 (Agargun MY et al.)
¹⁰Source : Manic-Depressive Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression, 2007 (Goodwin FK and Jamison KR)
¹¹Source : Levels and variability of daily life cortisol secretion in major depression, 2004
(Frenk Peeters et al.) / 24-h Monitoring of plasma norepinephrine, MHPG, cortisol, growth hormone and prolactin in depression, 2004 (Koenigsberg HW et al.)
¹²Source : Cortisol responses to daily events in major depressive disorder, 2003 (Peeters F et al.)
¹³Source : A chronobiological study of melatonin and cortisol secretion in depressed subjects: plasma melatonin, a biochemical marker in major depression, 1984 (Claustrat B et al.) / Melatonin secretion in SAD patients and healthy subjects matched with respect to age and sex, 2001 (Karadottir R. and Axelsson J.) / Diurnal profile of melatonin secretion in the acute phase of major depression and in remission, 2001 (Rabe-Jablonska J. and Szymanska A.) / Age, alcoholism and depression are associated with low levels of urinary melatonin, 1992 (Wetterberg L. et al.)
¹⁴Source : Interpersonal and social rhythm therapy for bipolar disorder: Integrating interpersonal and behavioral approaches, 1995 (Frank E. et al.) / Stressful life events, social rhythms, and depressive symptoms among the elderly: An examination of hypothesized causal linkages, 1994 (Prigerson HG et al.) / Social rhythm in anxiety disorder patients, 1994 (Shear MK et al.)
¹⁵Source : The Inflammatory Potential of the Diet is Directly Associated with Incident Depressive Symptoms Among French Adults, 2019 (Adjibade M. et al.) / Prospective association between adherence to dietary recommendations and incident depressive symptoms in the French, 2018 (Adjibade M. et al.) / Dietary flavonoid intake and risk of incident depression in midlife and older women, 2016 (Chang S.C. et al.) / Dietary Polyphenol Intake and Depression: Results from the Mediterranean Healthy Eating, Lifestyle and Aging (MEAL), 2018 (Godos J. et al.) / Inflammation mediates the association between fatty acid intake and depression in older men and women, 2016 (Lai J.S. et al.). / Dietary magnesium intake and the incidence of depression: A 20-year follow-up study, 2016 (Yary T. et al.)
¹⁶Source : Low dietary calcium is associated with self-rated depression in middle-aged Korean women, 2012 (Yun-Jung Bae and Soon-Kyung Kim)
¹⁷Source : Canadian study: SSRI increase Bone fracture risk, 2007 (Golzman D.)
¹⁸Source : Effect of nutrients (in food) on the structure and function of the nervous system: Update on dietary requirements for brain, 2006 (Bourre JM.)
¹⁹Source : Gut to brain dysbiosis: Mechanisms linking Western diet consumption, the microbiome, and cognitive impairment, 2017 (Emilie E. Noble et al.) / The Gut-Brain Axis: Influence of Microbiota on Mood and Mental Health, 2018 (Jeremy Appleton) / The gut-brain axis: Interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems, 2015 (Carabotti M et al.)
²⁰Source : Differential behavioral effects of gonadal steroids in women with and in those without premenstrual syndrome, 1998 (Schmidt PJ et al.) / Effects of gonadal steroids in women with a history of postpartum depression, 2000 (Bloch M, Schmidt PJ, Danaceau M, et al.)
²¹Source : Hippocampal formation: shedding light on the influence of sex and stress on the brain, 2007 (McEwen BS, Milner TA.) / Estrogen, menopause, and the aging brain: how basic neuroscience can inform hormone therapy in women, 2006 (Morrison JH et al.)
²²Source : Reproductive hormone sensitivity and risk for depression across the female life cycle: A continuum of vulnerability?, 2008 (Claudio N. Soares and Brook Zitek)
²³Source : Hormones and menopausal status as predictors of depression in women in transition to menopause, 2004 (Freeman EW, et al.)
²⁴Source : Rapkin AJ, Mikacich JA, Moatakef-Imani B, et al. The clinical nature and formal diagnosis of premenstrual, postpartum, and perimenopausal affective disorders. Curr Psychiatry Rep 2002
²⁵Source : Bennett HA, Einarson A, Taddio A, et al. Prevalence of depression during pregnancy: systematic review. Obstet Gynecol 2004 / Cohen LS, Altshuler LL, Harlow BL, et al. Relapse of major depression during pregnancy in women who maintain or discontinue antidepressant treatment. JAMA 2006
²⁶Source : No health without mental health, 2007 (Prince M et al.)
Cet article a été rédigé par Estelle Sovanna et il est issu du magazine Régénère n°16 "Cerveau, corps et santé".