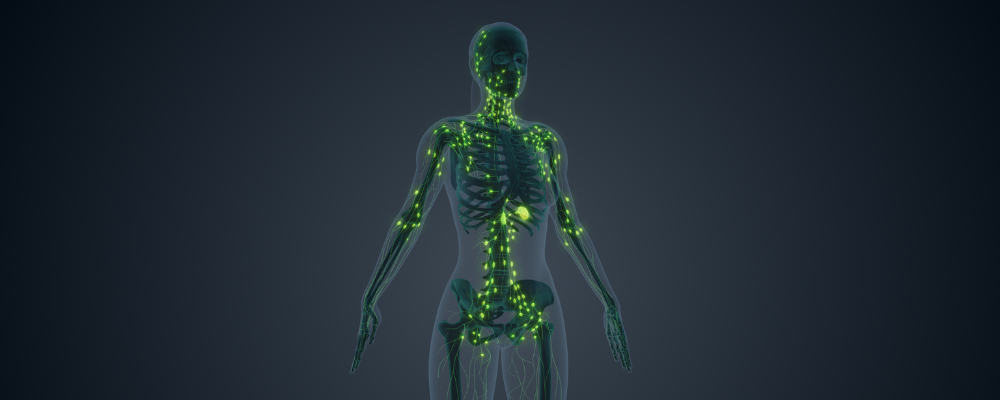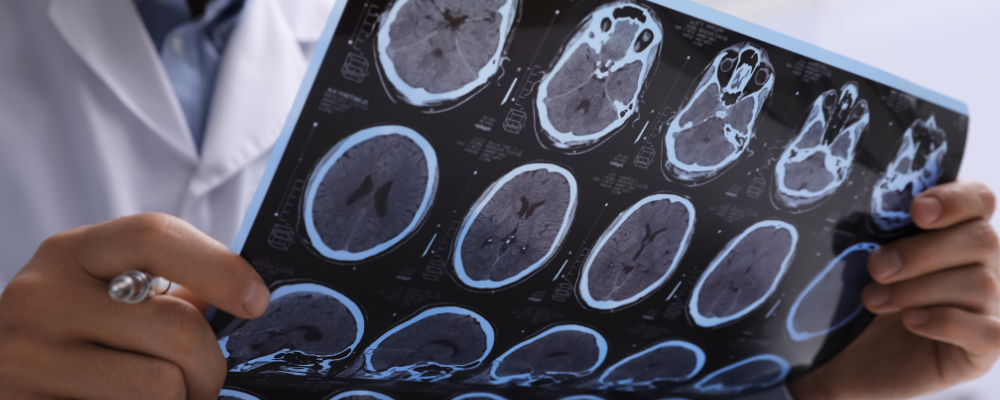On entend souvent qu’en hiver, il faut manger des aliments plus gras et plus chauds, mais n’est-ce pas un peu réducteur ? Plus on a froid et plus on est frileux, plus il est conseillé de consommer des produits denses et salés pour se réchauffer. Nous allons donc voir qu’il est judicieux d’adapter notre alimentation en hiver de manière à préserver la capacité de notre corps à produire de la chaleur.
DENSE ET SALÉ POUR RÉCHAUFFER
Un aliment est fait d’eau, de fibres (solubles et insolubles), et de nutriments. On nomme aliments denses ceux qui contiennent peu d’eau, donc qui sont concentrés en minéraux et chargés en calories, en opposition aux aliments aqueux qui contiennent un pourcentage élevé en eau, plus faibles en densité calorique et dans lesquels les minéraux sont plus dilués. Pour illustrer notre propos, prenons 100 grammes d’un aliment composé à 80% d’eau (non calorique) et 20% de matières sèches (caloriques). Ce produit est donc considéré aqueux, et présente une faible densité calorique. Si nous déshydratons cet aliment pour obtenir 80% de matières sèches (caloriques) et seulement 20% d’eau (non calorique), il ne pèsera plus que 40 grammes. On dit alors que cet aliment est dense ou concentré car il présente la même quantité de minéraux et de calories pour un poids moindre. Et si on veut retrouver 100 grammes de cet aliment déshydraté (donc concentré), ils seront quatre fois plus denses en minéraux et en calories. Par ailleurs, ajoutons également que les produits riches en lipides sont plus denses que les produits riches en glucides, car 1 gramme de glucides équivaut à 4 calories, alors que 1 gramme de lipides équivaut à 9 calories.
Parmi les fruits denses, on citera par exemple les avocats, la noix de coco, les olives, les dattes, et tous les fruits secs qui seront plus appropriés pour réchauffer le corps que les fruits aqueux comme le melon, la pastèque, l’orange, les raisins. Parmi les autres catégories d’aliments denses, on citera les produits animaux et les oléagineux car riches en lipides et faibles en eau, ou encore le miel car il ne contient pas d’eau du tout. Concernant les légumes, ils sont souvent riches en eau, pauvres en calories et pauvres en lipides, donc ils sont rarement considérés comme des produits denses. Mais parmi les légumes, il y a quand même des différences de densité entre une salade riche en eau et des légumes racines et des tubercules.
Quant aux aliments salés, ils sont riches en sels minéraux et particulièrement en sodium. Parmi les aliments salés, on nommera l’eau de Quinton (eau de mer), les algues, les produits animaux comme le poisson ou la viande séchée, les olives, et tous les aliments auxquels on ajoute du chlorure de sodium. Les fruits et légumes contiennent peu de sodium à l’état naturel. Les aliments salés sont les bienvenus pour réchauffer le corps en hiver, et le fait d’associer la densité et le caractère salé augmente le pouvoir réchauffant.
QUELQUES ALIMENTS RÉCHAUFFANTS
Les superaliments comme l’eau de mer, le miel, le pollen, la spiruline ; les épices comme le clou de girofle, la cannelle, le poivre, le cumin, le gingembre, le piment de Cayenne ; les aliments soufrés comme l’échalote, l’oignon, l’ail, la ciboule, la moutarde ; les aromates comme le thym, le laurier, le romarin ; les oléagineux comme les noix, les amandes ; les légumineuses comme les pois chiche, les lentilles, les haricots secs ; les légumes comme le panais, le potiron, la carotte ; les tubercules comme la pomme de terre, l’igname ; les céréales comme le riz, le sarrasin, l’avoine ; les champignons ; les produits animaux comme la viande et le poisson.
ISOTONIE DU SANG ET ÉQUILIBRE SODIUM/POTASSIUM
Pourquoi les aliments denses et salés vont-ils plutôt avoir tendance à réchauffer le corps alors que les produits aqueux et peu salés vont avoir tendance à le refroidir ? Pour y répondre, il faut revenir à la composition du sang et à sa concentration en minéraux qui doit rester fixe : c’est ce que l’on appelle “isotonie sanguine”. La concentration représente le rapport entre la quantité de minéraux et le volume sanguin total. Parmi ces minéraux, le sodium est celui qui est le plus largement présent dans le sang. Ainsi, lorsqu’on apporte une grande quantité d’eau faiblement chargée en minéraux par rapport à l’isotonie du sang, alors le volume sanguin va augmenter, mais la concentration en minéraux (et en sodium) va chuter proportionnellement. Pour éviter cette chute et garder cette concentration minérale stable, le corps va mettre en place plusieurs mécanismes de régulation : d’une part, il peut évacuer l’excédent d’eau par les urines, et/ou d’autre part, il peut aller puiser des minéraux et du sodium dans le milieu intracellulaire (c’est-à-dire à l’intérieur même des cellules) pour rétablir l’isotonie du sang dans le milieu extracellulaire (à l’extérieur des cellules). Dans le cas du deuxième mécanisme, cette extraction intracellulaire va créer une perte minérale, notamment en sodium, à l’intérieur même des cellules. En conséquence, c’est toute sa production d’énergie et de chaleur qui va diminuer car ce sont les mitochondries (à l’intérieur de la cellule) qui assurent la production de chaleur et d’énergie pour tout le corps. Ajoutons également que le corps tente de toujours maintenir un équilibre sodium/potassium. Si nous consommons trop d’aliments riches en potassium présent notamment dans les fruits, alors la balance sodium/potassium va se déséquilibrer, et nous perdons davantage de pouvoir réchauffant.
PRIVILÉGIER LES PRODUITS DISPONIBLES EN HIVER
Observons comme la nature est bien faite : il suffit de consommer les produits locaux et de saison car ils sont les plus adaptés à nos besoins du moment. C’est la raison pour laquelle nous trouvons des fruits et légumes gorgés d’eau en été pour nous rafraîchir (melons, pastèques, baies etc.), et des produits plus denses en hiver pour nous réchauffer (avocats, légumes racines, cucurbitacées, tubercules etc.). Citons le paradoxe de la crême glacée en été : malgré sa basse température qui nous donne la sensation de nous rafraîchir, elle demeure un produit concentré car riche en lipides et en sucres, et peu riche en eau (contrairement au sorbet), donc sa consommation va plutôt nous réchauffer. En été, il est préférable d’opter plutôt pour une tranche de pastèque. D’un autre côté, attention aux mandarines et aux oranges qui sont disponibles en hiver, mais qui sont des fruits aqueux importés des pays chauds (Maghreb) et implantés en Europe. À l’origine, nous avons beaucoup moins de fruits en hiver. Nos anciens n’en consommaient d’ailleurs quasiment pas ou alors ils avaient pour habitude de mettre du sel sur les rares fruits.
LES PERSONNES ÉPUISÉES SONT PLUS SENSIBLES AU FROID
Pour s’alimenter de façon adaptée, il est indispensable de prendre en compte la saison mais aussi notre terrain. En effet, une personne qui a bien chaud même en hiver - ce qui est souvent le cas des personnes en surpoids, hypertendues ou qui ont beaucoup de graisses brunes - pourra manger des produits aqueux sans risquer de se frigorifier. Pour une personne frileuse - ce qui est souvent le cas des personnes maigres, déminéralisées, hypotendues et épuisées - la règle va être de privilégier des produits denses, gras et salés pour réchauffer. Chez les personnes épuisées, on observe un défaut de production hormonale, dont la production de l'hormone cortico-surrénalienne : l’aldostérone. La fonction de cette dernière est de retenir le sel et les liquides à l’intérieur du corps. Elle permet de maintenir un volume plasmatique important avec un niveau de sodium et de minéraux élevé, donc de maintenir une tension relativement élevée. Ainsi, une personne épuisée aura tendance à ne retenir ni le sel (hyponatrémie) ni les liquides, et son volume plasmatique sera faible tout comme sa tension. Qui dit hypotension dit défaut de vascularisation, frilosité ainsi que d’autres symptômes (fatigue, dépression, troubles de la mémoire, de l’audition, de la vue) qui vont tous de pair car la tête fait partie des zones périphériques qui ont du mal à être irriguées. Plus on est épuisé, plus on aura froid en hiver. Comprendre ces principes physiologiques permet d’être libre d’adapter simplement son alimentation aux besoins du moment en fonction de son énergie et du climat, sans tomber dans un dogme.
MANGER CRU PAR CLIMAT FROID ?
Manger cru est plus adapté aux climats chauds. On optera plus facilement pour un régime riche en fruits et légumes crus tout au long de l’année dans les pays tropicaux, alors qu’à l’inverse on optera plutôt pour un régime avec beaucoup de produits animaux et/ou denses dans les régions très froides comme chez les inuits. Mais manger cru en hiver, c’est possible, car ce n’est pas tant une question de température qu’une question de densité, de graisse et de salé comme nous l’avons vu plus haut. De plus, manger chaud ne veut pas toujours dire manger cuit. Il existe en effet des recettes de soupes « crues » mais chaudes, ou des préparations au déshydrateur que l’on peut consommer chaudes. De l’autre côté, cru n’est pas systématiquement synonyme de « rafraîchissant » car on trouve des aliments crus denses comme le miel, les produits animaux, les oléagineux, les fruits secs, les algues, les légumes racines, cucurbitacées et les tubercules. Il n’est pas recommandé non plus d’ingérer des aliments glacés dans un environnement glacé. Pour manger cru par climat froid, il faut veiller à adapter la densité de l’alimentation, à avoir une chaleur intérieure bien stable, une vitalité assez importante avant de manger des aliments aqueux en plus grande quantité. Et pour réchauffer encore, on peut utiliser les épices. Cela fait penser à la diététique chinoise qui parle de YIN et de YANG. Conclure que le cru est YIN et que le cuit est YANG serait un raccourci. Ce qui est YIN est aqueux et peu chargé en sel et en minéraux. Ce qui est YANG est peu aqueux, dense et salé. Cette diététique propose de manger YANG si on est YIN et YIN si on est YANG.
Cet article a été rédigé par Lena Poirier et Estelle Sovanna et il est issu du magazine Régénère n°6 "Les bienfaits du froid".